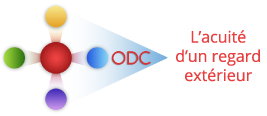Du 22 décembre 1941 (deux semaines après l’attaque de Pearl Harbor) au 14 janvier 1942 se tient à Washington la conférence Arcadia entre les Anglais et les Américains. Prélude à l’effort accordé à la victoire contre l’Allemagne. Et à ce qui deviendra l’opération OVERLORD. Difficile d’évoquer une bataille sans aborder sa planification. Et peu judicieux de ne pas en retenir les enseignements.
‘The Allied invasion of Normandy in June 1944 was almost certainly the most ambitious operation in the history of warfare. The tipping point between triumph and disaster was impossible to predict.’, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’
Suite à mon introduction publiée en avril dernier, voici le premier d’une série de trois articles que je consacre à quelques-uns des constats et enseignements des combats de 1944 sur les plages et dans la campagne normandes. Combats qui se déroulèrent dans le cadre de l’opération OVERLORD. Au programme : la planification, le commandement et les individus.
L’ordre du jour portera donc sur la planification.
Nous noterons que sur l’opportunité de la planification en général, les avis sont partagés. Certains en rejettent jusqu’à l’idée et privilégient la réaction. A l’opposé, d’autres en sont tellement friands qu’ils la confondent parfois avec le micromanagement. Dans le premier cas, nous courrons le risque que l’initiative appartienne à l’autre camp ; à l’ère de l’immédiateté – sans même parler des apports que nous escomptons de l’intelligence artificielle (IA) – cela s’avère hautement risqué. Dans le second, cela rime avec lourdeur et incapacité à réagir et à s’adapter. Ce qui se révèle tout aussi dangereux face à un adversaire agile et réactif, voire imprévisible.
Mais, quel que soit notre avis sur la question, nous devons bien admettre que sans planification le Débarquement n’aurait jamais eu lieu tant l’opération était complexe. Est-ce à dire que tout était parfait ? Certainement pas.
1. Importance et limites du plan des Alliés
‘Even the British Army had failed to listen to Field Marshal Brook’s warnings. He had bad experience of this countryside during the retreat of 1940 and foresaw the difficulties for the attack‘, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’
1.1 Importance de la planification
OVERLORD poursuivait un objectif majeur : saisir et de sécuriser une tête de pont devant servir de base d’assaut vers l’Allemagne. Pour ce faire, elle comportait elle-même plusieurs opérations. Le seul Débarquement sur les plages normandes (opération NEPTUNE) nécessitait son propre plan. Il s’agissait donc de coordonner l’ensemble de ces opérations ainsi que les moyens mis en œuvre. Celles-ci impliquaient plusieurs nations, plusieurs composantes (terre, air et mer) et plusieurs types de matériels. Sans perdre de vue une dimension logistique tout aussi importante et sur laquelle nous reviendrons (cf. § 3).
Commentaire : la planification générale pour OVERLORD débute activement en 1942. Initialement, elle prévoyait un double débarquement simultané, le second en Provence. Le plan évoluera ensuite en fonction de nombreux paramètres. Notons qu’en 1943 la prise de Paris figurait au programme (cf. ce document, p 65).
1.2. L’adversaire
Les Allemands s’attendaient à une tentative de débarquement. Pour contrer cette hypothèse, ignorant le lieu, le jour et l’heure, allant jusqu’à envisager une manœuvre de diversion, ils se retranchèrent derrière le « Mur de l’Atlantique » dans un complexe du type « Ligne Maginot ». En outre, ils comptaient sur de puissantes contre-attaques pour rejeter les envahisseurs à la mer.
1.3. Les limites des plans
‘[Due to] the bad weather on 5 June… the Kriegsmarine decided that it was not worth sending out naval patrols into the Channel that night. As a result the flotillas of Allied minesweepers were able to advance in line abreast towards the Normandy coast completely unobserved’, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’
Les plans des deux camps comptaient de sérieuses limites. Certaines existaient dès la planification. D’autres se révélèrent pendant les combats.
- Du côté des Alliés, l’effort de planification a porté sur le débarquement lui-même. C’est ainsi que, par exemple, l’étude du terrain au-delà des plages fut négligée et que les modes de combat dans le bocage normand s’adapteront dans la douleur.
- Les Allemands, en sus de se retrouver en réaction, s’appuyaient sur des divisions blindées dispersées et éloignées des plages. Ils se trouvaient également en butte au micromanagement, à commencer par celui d’Hitler (dont le sommeil au moment du Débarquement a régulièrement été évoqué). En outre, ils connaissaient des dissensions sérieuses au sein de la chaine de commandement.
- A cela s’ajoute un certain nombre de péripéties :
- des aléas météo, favorables tantôt à l’un ou à l’autre. Le mauvais temps a constitué un atout pour les Alliés qui purent compter sur l’effet de surprise ; par la suite, les jours de mauvaise visibilité procurèrent l’occasion aux convois allemands de déplacements de jour sans risque d’attaque de l’aviation adverse ;
- des délais inattendus. A titre d’exemple, Caen, supposée être libérée le 6 juin au soir, ne le fut que le 20 juillet. Au bilan, la bataille de Normandie durera près de trois mois (du 6 juin au 30 août 1944), ce qui ne sera pas sans conséquences ;
- des retards logistiques significatifs (dont nous reparlerons au § 3) ;
- des « variantements » importants en cours d’action. Ainsi, la libération de Paris ne figurait pas au plan définitif, lequel prévoyait une progression rapide vers l’est…
2. Renseignement et désinformation
‘The main contribution which the Resistance offered to the success of OVERLORD lay not in guerrilla action, but in intelligence and sabotage, contributing to the isolation of Normandy from the rest of France.’, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’
Mais, avant de lancer une opération, il est impératif de lever un maximum de doutes. Et, pour mettre toutes les chances de son côté, de réussir à tromper l’adversaire. Renseignement et désinformation font donc partie intégrante du plan.
2.1 Désinformer avant
‘Geyr, who believed like Guderian in the importance of a massive panzer counter-attack, was shaken to find how effective the Allied bombing of key towns had been blocking approach routes. Having strongly opposed the idea of deploying panzer divisions close to the coast, he still refused to acknowledge that Rommel’s healthy respect for Allied air power had been more prescient.’, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’
Que les Alliés débarquent, cela ne faisait aucun doute. Pour disposer d’un maximum de chances de succès, ils s’employèrent à désinformer les Allemands au moyen de plusieurs opérations spécifiques.
Pour ce qui est du lieu (où ?), ce fut, notamment, l’objectif d’une opération de grande ampleur : FORTITUDE. Il s’agissait de persuader l’adversaire que le Débarquement s’effectuerait dans le Pas-de-Calais. Ce fut une réussite. En effet, même si certains généraux allemands (comme le maréchal Rommel) envisageaient plutôt une offensive en Normandie, le grand état-major allemand acheta l’idée. Laquelle perdura, même dans les jours qui suivirent le Débarquement.
Pour ce qui est du moment (quand ?), les différents protagonistes disposaient des mêmes éléments d’analyse (notamment au regard des marées). Les principaux points d’interrogation résidaient dans la volonté de prise de risque et dans les possibilités (réduites) de report.
Pour ce qui concerne les moyens (avec quoi ?), la désinformation joua, là encore, pleinement son rôle. L’Angleterre constituant la base de départ évidente, tout fut fait pour tromper les services de renseignement ennemis : fausses unités, engins factices, simulations d’entraînement ; et même un vrai général paradant à la tête de cette armée fantôme. En l’occurrence le général Patton.
2.2 Désinformer pendant
‘The only benefit from Operation GOODWOOD [12 juillet] was that Eberach and Kluge became even more convinced that the major attack in Normandy would still come on the British front and head for Paris.’, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’
Créer la surprise se prépare. Mais celle-ci peut être renforcée en conduite. Et certains évènements parviennent, parfois de manière inattendue, à l’entretenir.
C’est ainsi que, dans la nuit du 5 au 6 juin, le parachutage de poupées dans la profondeur trompe les Allemands.
Parallèlement, une opération est lancée en Bretagne. A défaut d’atteindre son principal objectif (la prise d’un port majeur à des fins logistiques) et de véritablement désinformer l’adversaire, elle le distraira de l’effort principal, notamment lors de l’opération Cobra déclenchée en juillet dans la Manche.
Il s’agit donc, ici, d’opportunisme. Mais d’autres actions contribueront, même involontairement, à induire l’adversaire en erreur. Cela procède du « brouillard de la guerre ». Prenons l’exemple de l’opération GOODWOOD mentionnée dans la citation ci-dessus. Menée par les Britanniques du 18 au 20 juillet, elle se révèle désastreuse : elle se solde par la perte de 6000 hommes et de près de 500 chars ; en outre les objectifs tactiques ne sont pas atteints. Cependant, cela contribuera à tromper les Allemands sur l’axe d’effort des Alliés.
2.3 Le renseignement
‘Patton’s charge in Brittany… soon became confused, if not chaotic. This was partly due to bad communications. The radio sets were simply not good enough for the distances involved’, Anthony BEEVOR, ‘D-Day. The battle for Normandy’
Avec l’exemple de GOODWOOD, nous sommes à la frontière entre l’appréciation de situation et le renseignement.
Celui-ci s’est révélé, plus que jamais, capital.
Le fait d’avoir auparavant saisi Enigma et percé les codes allemands a constitué un gain inestimable. Et cela a grandement servi dans le cadre des opérations de désinformation.
Par ailleurs, comme nous l’avons vu, l’effort initial portait sur les plages de débarquement et certains objectifs clefs. Là, les réseaux de la Résistance jouèrent un rôle essentiel, qu’il s’agisse des travaux de fortification du « Mur de l’Atlantique » ou de la nature et du positionnement des forces allemandes. Même si toutes les informations n’étaient pas à jour – la diffusion en temps réel n’était guère envisageable – elles étaient suffisamment nombreuses pour bénéficier aux unités d’assaut. Lesquelles obtinrent également, en de nombreuses occasions, du renseignement ponctuel d’opportunité, par exemple à l’approche de villages.
Au-delà, le renseignement militaire se poursuit, mais est loin d’être parfait, entre autres en raison des élongations. Les Allemands, eux, se retrouvent rapidement avec des moyens de communication réduits (du fait, notamment, de la Résistance) ; les comptes-rendus, lorsqu’ils parviennent, se révèlent souvent trop tardifs. Les Alliés rencontrent également d’importants problèmes entre la confusion qui règne sur le front – avec parfois un trop grand nombre de messages à trier – et les difficultés de circulation routière liées aux destructions, aux combats et à la logistique.
3. La logistique
« Si la logistique dit non c’est elle qui a raison, il faut changer le plan d’opération », phrase attribuée au général Eisenhower
Pour ceux qui en douteraient, la logistique fait partie intégrante de la planification dont elle constitue un pan essentiel.
3.1 De l’idée générale…
J’écris plus haut « attribuée » car cela fait de nombreuses années que j’entends et que je lis la maxime du général Eisenhower. Or, j’ai essayé d’en retrouver la source – en passant par quelques biographies – mais en vain. Ceci dit, s’il ne l’a pas formulée, il aurait pu la prononcer ou la penser. Contrairement à ce que certains prétendent, ce n’était pas un logisticien, mais il avait parfaitement compris le problème. Ses fonctions précédentes – chargé de la répartition des moyens entre le théâtre de l’Atlantique et celui du Pacifique, puis chef de la division opérations à l’état-major du général Marshall à Washington – ont très certainement aidé.
Or la logistique est un élément clef d’Overlord. Ce à deux titres : le soutien de la force de débarquement d’abord – initialement, plus de 150 000 soldats, des milliers de véhicules, de très grandes quantités de munitions ; celui de la force d’invasion ensuite – transport des renforcements (combattants, matériels) et des ravitaillements. Simultanément, il s’agissait d’assurer l’évacuation des blessés (150 000 évacués en 3 mois, autant que les troupes initiales) et des matériels à réparer vers l’Angleterre.
3.2 … à la réalisation
En ce domaine, l’idée stratégique consiste à saisir des ports. Or, ceux-ci seront évidemment indisponibles au début de l’offensive et partiellement détruits après. Les alliés vont donc innover avec deux ports artificiels, à Omaha Beach (mais détruit par une tempête le 19 juin !) et à Gold Beach (Arromanches). Ils vont compléter le dispositif par un oléoduc sous-marin (« Pipeline Under The Ocean« ).
Mais, malgré l’anticipation et l’innovation, la logistique va connaitre des déboires. En sus de la tempête ayant détruit le port artificiel d’Omaha, elle va, avant de parvenir enfin à activer le red ball express, s’empêtrer dans un gigantesque embouteillage. Celui-ci est principalement dû à la lenteur de la progression les premiers mois. Partant, le ravitaillement s’amoncèle sur les plages. Cela rend le tri et le transport difficiles. Ce dernier se trouve englué dans les problèmes de circulation déjà évoqués au § 2.3. Avec les conséquences que l’on peut imaginer. Et, donc, un retard accru dans la réalisation du plan.
Quant aux Allemands, entre les sabotages et la quasi-suprématie aérienne alliée, la logistique se réduisit rapidement comme peu de chagrin.
4. Donc…
« Et si c’était à refaire ? », la bonne et dernière question de toute séance d’analyse après action (3A) digne de ce nom.
A l’évidence, les enseignements sont nombreux. Beaucoup d’entre eux ont servi au cours des décennies suivantes. Reste à savoir si leur validité perdure(ra) à l’ère du numérique et, surtout, de l’intelligence artificielle (IA). Prenons en quelques-uns.
4.1 Sur la planification
L’opération OVERLORD illustre le fait que la planification est indispensable pour tout projet d’envergure et qu’elle :
- doit être exhaustive et bien prendre en compte l’interdépendance de tous ses aspects ;
- doit être flexible, prévoir des marges de manœuvre et plusieurs options – des « en mesure de » – suffisamment détaillées pour pouvoir être immédiatement mises en œuvre ;
- dépend d’une bonne gestion du renseignement ;
- nécessite une logistique appropriée.
4.2 Sur le renseignement et la désinformation
- Le renseignement – sur les objectifs de l’adversaire, sur ses capacités, sur le terrain et l’environnement – est impératif, au minimum, pour limiter les risques et réduire l’incertitude. Au mieux, et de préférence, pour anticiper et prendre l’initiative.
- Il constitue un élément majeur de l’appréciation de situation et de la prise de décision (comme cela a pu se vérifier pour OVERLORD ou, pour prendre un autre exemple, à l’occasion de la bataille de Midway (1942)). A une condition, cependant : que le décideur sache prendre de la distance avec ses idées premières (pour ne pas dire reçues).
- En outre, il permet de déterminer les éléments les plus propices à une opération de désinformation (et/ou d’influence), laquelle permet de surprendre, voire de paralyser l’adversaire.
- Mais il est étroitement lié au maintien de capacités de communication.
4.3. Sur la logistique
- Pour être efficace, le plan doit s’appuyer sur la logistique.
- Pour que celle-ci soit adaptée, elle doit être conçue en même temps que le plan, voire le précéder. Cela a été le cas pour OVERLORD où l’un des maîtres mots fut l’anticipation.
- Et comme elle sera inévitablement contrainte par le rythme de l’action, il vaut mieux, là aussi, prévoir des options et des marges de manœuvre.
4.4. Et l’IA dans tout cela ?
L’apport de la numérisation du champ de bataille et de l’intelligence artificielle à ces trois domaines est indéniable. Cela se traduit, par exemple, par la capacité à étudier de multiples scénarios à partir d’un nombre très important de données variables.
Cela dit, deux questions se posent :
- celle de la validité des données. Avec le risque qu’elles soient erronées, involontairement… ou non ;
- celle de la prise de décision. Qui s’appuiera toujours sur un certain degré accepté de prise de risque. D’où l’importance de bien connaitre l’adversaire et… ses partenaires.
*
Reste à méditer ces deux phrases :
« Pour comprendre l’espace dans lequel nous agissons, il faudrait commencer par s’extraire de la tyrannie du temps court et de l’uniformisation de l’information », général (2S) Didier Castres, « La fin de l’imaginable » (2023).
« Nous ne pouvons pas connaître, par principe, le présent dans tous ses détails », cité dans l’article d’Heisenberg sur le rôle central de l’incertitude dans le monde quantique (1927), Kaid Bird & Martin J. Sherwin, « Robert Oppenheimer. Triomphe et tragédie d’un génie » (2005 – édition française de 2023).
Photo en en-tête :@2024olivierdouin, HMS Prince of Wales, Portsmouth, Angleterre