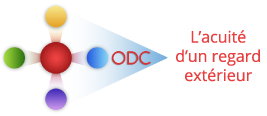Entre contrainte et devoir assumé, il y a un fossé. Que le cinéma illustre parfois là où on ne l’attend pas.
Le docteur MILLER : « Non ! Vous êtes malade ? » [ironique]
Le capitaine ROPER : « Je suis fatigué »
Le docteur MILLER : « Allez vous coucher »
Le capitaine ROPER : « Écoutez, docteur, je vous interroge sur sa santé. Je ne vous questionne pas sur moi »
Extraits du film Fort Bravo (1953). Titre original: Escape from Fort Bravo
Beaucoup subissent leur sort. Dans ces conditions faire son devoir relève, au minimum, de la corvée. D’autres l’acceptent, y compris dans des circonstances éprouvantes, quelles que soient leurs motivations. Et cela fait une très grande différence sur ce que nous ressentons, ce que nous faisons et ce que nous sommes.
D’une manière générale, un film (ou une série) présente la plupart du temps plusieurs degrés de lecture assortis de plusieurs calques. Avec Fort Bravo, je vous propose d’examiner celui sur le sens du devoir.
Introduction
Le western classique est un genre essentiellement marqué par l’action, même si, parfois, quelques messages plus ou moins subliminaux apparaissent ici ou là.
Prenons le cas de John Sturges. Beaucoup se souviennent des films épiques que sont « Règlements de comptes à OK Corral » sorti en 1957 et, tout particulièrement, « Les 7 mercenaires » réalisé en 1960. Or, en 1953, il tourne« Fort Bravo » beaucoup moins connu. Certains critiques et spectateurs jugent ce film comme moins achevé ; selon moi parce que plus porté sur la réflexion que sur l’action, même si celle-ci ne manque pas.
Et c’est pourtant cette réflexion – laquelle couvre une thématique étendue – fait la force de ce film. Réflexion sur le pays. Sur les individus. Sur l’un d’entre eux en particulier, le capitaine ROPER (interprété par William Holden) – le héros, mais en est-il un ? Le tout mis en rapport avec le devoir, contraint ou consenti.
1. Le cadre de l’action : une prison impitoyable
Le lieutenant BAILEY au capitaine MARSH : « C’est affreux ce pays. Ce désert, la mort, c’est tout ».
Carla FORESTER à ROPER : « Je ne savais pas si c’était un cauchemar ou la réalité »
Cela peut paraitre contradictoire, mais l’histoire s’apparente à un huis-clos, même si elle se situe en Arizona, durant la guerre civile américaine (1861-1865). Qui plus est, le film a été tourné au Nouveau Mexique et dans la Vallée de la Mort au Nevada.
Car, en fait, ces grands espaces constituent une véritable prison.
1.1. Fort Bravo, un pénitencier
YOUNG (prisonnier confédéré) à Campbell (autre prisonnier) : « Je voudrais savoir ce qu’une vieille ganache comme vous fait dans cette guerre »
CAMBELL : « C’est pourtant très simple. Les petits jeunots comme toi se faisaient battre »
Le fort sert ici de prison à des soldats confédérés.
Mais la situation est déséquilibrée :
- les militaires nordistes qui les gardent ont vu leurs effectifs réduits. Partant, les gardiens se retrouvent en infériorité numérique ;
- ces derniers, bien qu’ils incarnent l’autorité, donnent des signes de dissensions. A l’évidence, certains n’approuvent pas l’attitude de ROPER. A commencer par son chef, le colonel OWENS (Carl Benton Reid) : « C’est heureux que vous soyez dans la même armée que moi, ROPER. Votre conduite est admirable. Mais aujourd’hui je ne vous approuve pas du tout » ;
- à contrario, les Sudistes restent globalement disciplinés, sous l’autorité du capitaine MARSH (interprété par John Forsythe). Celui-ci, malgré les différences de caractères et de générations, parvient à planifier une évasion.
Or, la situation géographique du fort contribue à tout compliquer.
1.2. Fort Bravo, isolé dans un cadre hostile
Le colonel OWENS : « Ce sont mes nerfs qui me lâchent ou alors je me fais trop vieux. »
Le capitaine ROPER : « Comment rester jeune dans un pays où il est déjà si difficile de vivre, mon colonel ? »
En effet, le fort se trouve isolé au beau milieu d’une zone désertique. Seul signe de civilisation : une (toute) petite ville située à quelques kilomètres. Au-delà, c’est terrain libre jusqu’au Texas, l’état confédéré le plus proche.

L’évasion, donc, semble vouée à l’échec. D’ailleurs, la scène d’ouverture montre ROPER ramenant le lieutenant BAILEY (John Lupton). Pour ce faire, il le tire littéralement attaché à son cheval à travers le sable.
Tout, ici, préfigure le roman de Cormac McCarthy, No country for old men (2005), et le film du même titre réalisé en 2007 par les frères Coen.
1.3. Fort BRAVO, assailli par les Apaches
Le lieutenant BEECHER : « : Alors c’est comme ça qu’on fait la guerre »
Le capitaine ROPER : « On ne vous l’a pas appris à l’Académie [West Point, NDA] ? »
Non, le fort n’est pas assiégé, du moins pas encore. Mais les Apaches sont partout et tiennent la région.
Ce sont eux, d’ailleurs, qui, à force d’embuscades, réduisent les effectifs de la garnison Et se montrent impitoyables, comme s’en émeut le lieutenant BEECHER (Richard Anderson). Dès lors, il est quasiment impossible de se déplacer sans escorte militaire.
Fins tacticiens, guerriers redoutables, à l’instar du désert ils ne laissent guère de chance à leurs adversaires. Surtout lorsque ces derniers sont isolés ou peu nombreux. En outre, ils ont d’autant plus les coudées franches que les soldats sont englués ailleurs dans leur guerre fratricide.
Dans un tel contexte, il faut, inévitablement un personnage à la hauteur.
2. Le capitaine ROPER : prisonnier du devoir…
Son ordonnance à ROPER : « Vous reviendrez mon capitaine. Seuls les bons meurent jeunes »
ROPER : « Alors je suis certain de mourir centenaire »
L’ordonnance : « Vous êtes immortel, vous »
D’emblée, le capitaine ROPER apparait à la fois comme dur, impitoyable, expérimenté, compétent et exigeant. Il est donc parfait pour remplir la mission qui est la sienne.
2.1. La mission avant tout
Le docteur MILLER: « ROPER, il existe deux importantes missions en ce monde. La première consiste à sauver la vie des hommes. La deuxième est la vôtre semble-t-il »
Le capitaine ROPER est un geôlier. Mais il est également un chasseur redoutable : il retrouve et ramène systématiquement les évadés. Il ne relâche jamais sa vigilance et ne se détend que le soir, dans son logement ou, momentanément, à l’occasion d’une discussion sur le terrain. Il connait d’ailleurs celui-ci comme sa poche, et son adversaire également.
A l’évidence, la mission prime. Et il entend assumer ses responsabilités.
2.2. Des attentes élevées
ROPER à Carla FORESTER : « je n’aime pas la médiocrité »
Au cas où nous en aurions douté, cette phrase décrit bien le personnage. Il attend beaucoup des autres. Mais il est particulièrement exigeant avec lui-même. Il ne se pardonne aucun faux pas, encore moins la moindre erreur.

Et il est tout aussi exigeant envers les prisonniers. Après avoir ramené BAILEY au début du film, ne déclare-t-il pas au capitaine (confédéré) MARSH : « Si BAILEY s’était conduit en homme et m’avait résisté je ne l’aurais pas ramené comme cela. Mais c’est un lâche et un imbécile aussi. » ?
2.3. Une opposition générale
ROPER : « Ça leur déplait ce retour »
BEECHER : « Et je suis de leur avis »
ROPER : « L’unanimité est contre moi »
ROPER fait donc l’unanimité contre lui. Il en a parfaitement conscience. Celle des prisonniers lui est tout naturellement acquise. Une succession de scènes viennent ensuite démontrer celle des Nordistes : son entretien avec son commandant, suivi de l’échange avec le lieutenant BEECHER. Puis vient son dialogue avec le docteur MILLER.
Il en est donc conscient – à BEECHER : « Ça leur déplait ce retour ». Il n’évite pas le sujet – à MILLER : « Alors parlez. Je vous écoute ». Il assume pleinement et constate simplement – à MILLER encore « Docteur, je n’ai pas créé le monde ».
Le capitaine ROPER est, tout comme les autres protagonistes, un prisonnier : prisonnier du fort, mais aussi prisonnier de son devoir. Cependant, à l’instar du personnage lui-même, ce n’est pas si simple.
3. … mais libre intérieurement
ROPER à MARSH : « C’est celle qui triomphe, la bonne [cause] »
Car il est également libre… à sa manière.
3.1. L’acceptation du devoir
BEECHER : « Pour quelle raison font-ils ça ? »
ROPER : « Quand on est dans la tombe, peu importe comment on est mort. On se fiche de tout. »
BEECHER : « Je ne suis pas de cet avis. Regardez, c’est atroce »
ROPER : « Écrivez au ministère de la guerre »
Tout d’abord, et peut-être surtout, outre le fait qu’il s’assume pour ce qu’il est, le capitaine ROPER accepte la mission qui est la sienne et connait son devoir.
Sur ce point, une phrase dit tout : « Quelqu’un doit le faire ».
Quand il se trouve face à un dilemme, il en revient toujours à sa mission et à son rôle. Si, paradoxalement, il est enfermé dans son propre sens du devoir, il le ressent plus comme un impératif que comme une contrainte.
En outre, malgré les apparences, il ne se tient pas au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture du pantalon. Bien au contraire, il considère la situation avec réalisme et procède à sa propre analyse. Son sens du devoir ne vient donc pas uniquement des ordres de ses supérieurs.
3.2 Une sensibilité réelle
CARLA FORESTER : « C’est vous qui les soignez [les fleurs] ? »
ROPER : « Le geôlier à la rose. Un bon sujet de plaisanterie »
CARLA : « Un arrosoir dans un gant de fer »
La poésie tient une place intéressante dans ce film. BAILEY – dont MARSH dit que « c’est un enfant et un poète » – cherche à provoquer ROPER sur ce terrain : « Vous ne comprendriez pas ». Et pourtant, à sa manière, ROPER est également un poète, qu’il parle d’absolu ou qu’il soigne ses fleurs.

Par ailleurs, il pratique l’humour. S’il assume pleinement sa manière de remplir sa mission, il sait également le formuler à son endroit. Par exemple avec CARLA FORESTER (interprétée par Eleanor Parker), comme le montre sa répartie ci-dessus ou, plus tard, après avoir été berné : « ce n’était pas difficile [de me ridiculiser] » ; avec son ordonnance (cf. la partie précédente) ; ou encore au saloon quand une femme l’aborde « C’que j’aime ça un homme qui porte un uniforme » et qu’il rétorque « alors laisse-moi le garder ».
Enfin, au-delà de sa mission, il connait la compassion, par exemple en cherchant à éviter que BEECHER ne parte en mission le lendemain de son mariage avec la fille du colonel. Tout comme il sait témoigner sa reconnaissance : « BAILEY c’est bien ce que vous avez fait ».
Mais il y a plus.
3.3. L’amour les yeux ouverts
ROPER au sergent CHAVEZ : « C’est insensé Chavez que dans un magnifique pays comme celui-ci les hommes puissent songer à s’entretuer »
Le sergent CHAVEZ : « C’est vrai. C’est insensé. »
Si le capitaine ROPER accepte sa mission, assume son devoir et se déclare en quête d’absolu, il est, par dessus tout, un amoureux de la région dans laquelle il sert. Et de la nature aussi. Clairement, tout ce qui caractérise ROPER et tout ce qu’il aime se trouve ici : à CARLA FORESTER il déclare « Nous sommes au pays de l’absolu, en effet. Je pense que c’est pour ça que je l’aime tant » ; celle-ci lui demande alors : « C’est tout ce que vous demandez à la vie, n’est-ce-pas, l’absolu ? ».
Mais il se montre également honnête, avec lui-même et avec CARLA. Il y a un seuil qu’il n’a, jusqu’alors, jamais franchi : « Il y a un genre de vie [le mariage] que je voudrais connaitre depuis longtemps. Je n’ai jamais réussi. Mais peut-être en avais-je peur. Ou peut-être avais-je peur d’essayer, je n’en sais rien. Ou alors je n’ai jamais vraiment aimé ».
Après cette déclaration pour le moins cérébrale, CARLA s’enfuit avec le capitaine MARSH et une poignée d’évadés : elle était venue au fort pour faciliter l’évasion. Si bien que, malgré ses dénégations, il est difficile de penser que ROPER se lance à leur poursuite motivé uniquement par son sens du devoir.
Conclusion
ROPER : « Un jour viendra où tout prendra un sens »
CHAVEZ : « Pour ceux qui seront en vie, mon capitaine »
Le capitaine ROPER est donc un homme de devoir. Mais il l’assume comme une responsabilité choisie car il comprend la nécessité de son rôle.
Il est donc libre professionnellement. Et, en faisant un pas vers les autres, il gagne également sa liberté au plan personnel.

Photo en en-tête : @2009olivierdouin, Monument Valley (USA)